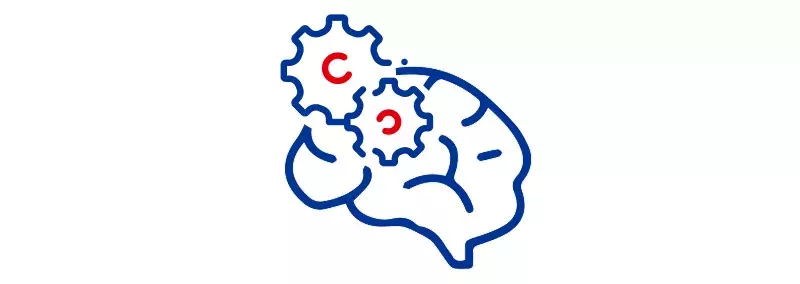La prévention du stress au travail
Publié le Mis à jour le 30/09/2025 |
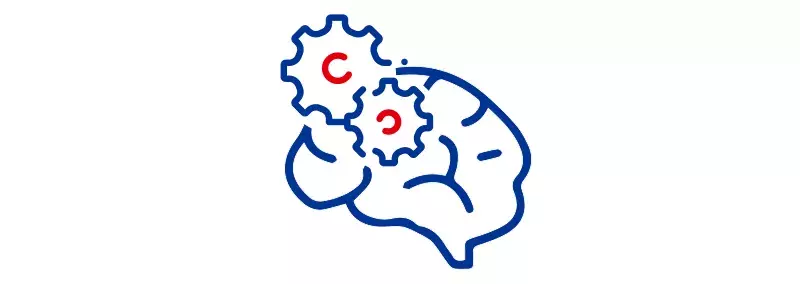
- L’état de stress au travail résulte d’un déséquilibre entre la perception qu’une personne a des contraintes qui lui sont imposées et la perception qu’elle a de ses propres ressources pour y faire face.
- Physiologiquement, l’état de stress se caractérise par trois phases :
- L’alarme, durant laquelle l’organisme se prépare au combat ou à la fuite ;
- La résistance, lorsque la situation stressante persiste et durant laquelle l’organisme doit mobiliser d’importantes ressources pour y faire face ;
- L’épuisement, lorsque la situation devient chronique ou s’intensifie.
- Ces situations de stress et de souffrance au travail mettent en évidence l’intérêt de prévenir les risques psychosociaux (RPS) susceptibles d’affecter la santé des travailleurs, tant mentale que physique (avec notamment un risque accru de développer des troubles musculo-squelettiques).
- Ces risques psychosociaux doivent être évalués et traités par les employeurs, au titre de leur obligation d’assurer la santé et la sécurité des travailleurs (articles L. 4121-1 et suivants du Code du travail).
- Lorsque le travailleur est submergé par l’état de stress, sa santé physique et psychique est alors mise à mal, pouvant conduire à une reconnaissance d’accident de travail ou de maladie professionnelle.
- Les RPS ne concernent pas seulement l’individu, mais reflètent souvent des dysfonctionnements organisationnels et des évolutions dans l’entreprise, telles que des transformations structurelles ou une mauvaise gestion du travail. Les facteurs de risques psychosociaux et de stress au travail sont notamment :
- La surcharge de travail ou une mauvaise gestion du temps de travai ;
- La dégradation des relations, liée par exemple à un manque de clarté dans les consignes ;
- Une faible cohésion d’équipe ;
- L’absence d’autonomie ;
- Le manque de valorisation et de confiance, souvent matérialisé par un contrôle excessif ;
- L’insécurité quant à l’avenir professionnel.
Le stress lié au travail : définition et manifestations
L’accord interprofessionnel du 2 juillet 2008 relatif au stress au travail étendu par arrêté du 23 avril 2009 définit le stress comme un état survenant « lorsqu’il y a déséquilibre entre la perception qu’une personne a des contraintes que lui impose son environnement et la perception qu’elle a de ses propres ressources pour y faire face. L’individu est capable de gérer la pression à court terme mais il éprouve de grandes difficultés face à une exposition prolongée ou répétée à des pressions intenses ».
L’Institut national de Recherche en Santé (INRS) identifie trois phases physiologiques du stress :
La phase d’alarme, durant laquelle l’organisme se prépare « au combat ou à la fuite »
Lorsque le travailleur est confronté à une situation évaluée comme stressante, son organisme réagit immédiatement en produisant des hormones qui augmentent sa fréquence cardiaque, sa tension artérielle, dans le but de maintenir ses niveaux de vigilance.
La phase de résistance, lorsque la situation stressante persiste
Peu de temps après la première phase, de nouvelles hormones sont sécrétées pour apporter l’énergie nécessaire aux muscles, au cœur et au cerveau pour répondre aux dépenses énergétiques nécessaires à l’organisme pour répondre à la situation stressante.
La phase d’épuisement, lorsque situation devient chronique ou s’intensifie
Le travailleur est submergé et son organisme ne parvient plus à s’adapter à la situation, mettant à mal sa santé physique et mentale : troubles musculo-squelettiques, troubles anxio-dépressifs, etc.
Pour en savoir plus, se reporter à l’article de l’INRS : Les effets sur la santé du stress au travail.
Si l’état de stress en tant que tel ne fait pas partie des maladies prises en charge au titre des affections professionnelles (maladies désignées dans un tableau des maladies professionnelles de la sécurité sociale), il peut néanmoins faire l’objet d’une reconnaissance en tant que maladie professionnelle, lorsqu’il est établi que les affections découlant de cet état sont essentiellement et directement causées par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux supérieur à 25 %.
(Article L.461-1 du Code de la sécurité sociale)
En 2023, les maladies psychiques reconnues d’origine professionnelle étaient en forte hausse (+ 25 %) et 12 000 accidents du travail étaient liés à ces risques (régime général).
La reconnaissance de maladie professionnelle peut intervenir au terme d’une procédure d’instruction impliquant la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Pour faciliter la bonne prise en charge des pathologies psychiques, il est prévu que le médecin-conseil de la caisse ou le comité puissent recueillir l’avis d’un médecin spécialiste en psychiatrie.
(Article. D. 461-27 du Code de la sécurité sociale)
À savoir !
Lorsque l’absence prolongée d’un salarié pour cause de maladie résulte d’un épuisement professionnel (notamment en lien avec une surcharge de travail et une exposition à un stress permanent et prolongé) et d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, les conséquences de cette absence sur le fonctionnement de l’entreprise ne peuvent être invoquées pour justifier un licenciement.
(Cass. Soc., 13 mars 2013, n° 11-22.082).
Dans son rapport de 2016, Stress au travail : un défi collectif, l’Observatoire international du Travail (OIT) faisait état de quarante millions de personnes affectées par le stress lié au travail au sein de l’Union européenne (au titre des données collectées au cours de la quatrième enquête européenne sur les conditions de travail, EWCS, 2007). « Selon le rapport de l’Observatoire européen des risques publié en 2009, le stress lié au travail représente en Europe entre cinquante et soixante pour cent des journées de travail perdues. »
Adopter une approche collective et préventive du stress au travail
Le stress est un risque psychosocial majeur à appréhender collectivement par employeurs, salariés et représentants.
En 2008, l’accord interprofessionnel relatif au stress au travail relevait ainsi la nécessité :
- D’accroître la prise de conscience et la compréhension du stress au travail, par les employeurs, les travailleurs et leurs représentants ;
- D’alerter sur les signes précurseurs ;
- De fournir un cadre qui permette de détecter, de prévenir, d’éviter et de faire face aux problèmes de stress au travail, sans individualiser la responsabilité mais en privilégiant une approche collective.
L’évaluation des facteurs de risques psychosociaux permet d’agir sur les causes organisationnelles susceptibles de favoriser l’apparition de souffrances et de stress au travail.
Conformément à l’article L. 4121-1 du Code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
- La mise en œuvre d’actions de prévention des risques professionnels ;
- Des actions d’information et de formation ;
- L’adaptation des organisations en fonction de l’évolution des risques et la mise en place de moyens adaptés.
Ces mesures doivent être régulièrement adaptées en concertation avec les acteurs de l’entreprise.
(Article L. 4121-1 du Code du travail)
Voir aussi Les grands principes de la prévention des risques professionnels et le DUERP.
Six grandes familles de facteurs de risques psychosociaux sont identifiées :
- Exigences du travail : surcharge ou sous-charge, pression temporelle, objectifs flous ou inatteignables.
- Exigences émotionnelles : relation à la clientèle, gestion des émotions, exposition à la souffrance.
- Manque d’autonomie : absence de marge de manœuvre, contrôle excessif.
- Rapports sociaux dégradés : conflits, isolement, absence de soutien hiérarchique ou collègue.
- Conflits de valeurs : sentiment d’incohérence entre le travail demandé et ses valeurs professionnelles.
- Insécurité socio-économique : crainte de la perte d’emploi, manque de reconnaissance.
L’interaction de ces facteurs favorise l’apparition du stress.
Ces facteurs de risques s’expriment dans :
- L’organisation et les processus de travail (aménagement du temps de travail, dépassement excessifs et systématiques d’horaires, degré d’autonomie, mauvaise adéquation du travail à la capacité ou aux moyens mis à disposition des travailleurs, charge de travail réelle manifestement excessive, objectifs disproportionnés ou mal définis, mise sous pression systématique, etc.) ;
- Les conditions et l’environnement de travail (exposition à un environnement agressif, à un comportement abusif, au bruit, à la chaleur, à des substances dangereuses, etc.) ;
- La communication (incertitude quant à ce qui est attendu au travail, perspectives d’emploi, changements à venir, mauvaise communication concernant les orientations et les objectifs de l’entreprise, etc.) ;
- Les facteurs subjectifs (pressions émotionnelles et sociales, impression de ne pouvoir faire face à la situation, perception d’un manque de soutien, difficulté de conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle, etc.).
Les leviers de prévention
Dans le cadre de l’évaluation et de la prévention des risques pesant sur la santé et la sécurité des travailleurs, six grands axes de prévention des RPS existent :
- Informer et former les travailleurs ;
- Réguler la charge de travail ;
- Garantir un soutien social solide ;
- Favoriser l’autonomie et la participation des salariés ;
- Assurer une juste reconnaissance du travail ;
- Discuter des critères de qualité du travail.
Ces axes de prévention impliquent :
- L’évaluation fine, par métier ou unité de travail, des six familles de facteurs de RPS, notamment par la mise en œuvre de questionnaires (sur ce point, consulter la page dédiée, sur le site de l’INRS) ;
- La régulation collective des dysfonctionnements et des potentielles sources de RPS, en agissant sur l’organisation et les relations de travail, en garantissant la cohésion d’équipe, en mobilisant les organes de représentation du personnel par un dialogue social constructif, notamment lors de la mise à jour du DUERP ;
- L’évaluation, le suivi et la régulation de la charge de travail, notamment afin de maintenir un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, de respecter le droit à la déconnexion, etc. ;
- L’engagement d’une réflexion sur la perception de la qualité du travail pour l’ensemble des travailleurs ;
- Le développement d’un soutien aux travailleurs (par le biais de formations, de cellules d’assistance psychologique, etc.), en lien avec le service de prévention et de santé au travail ;
- L’attention portée aux formes de reconnaissance et de rétribution du travail juste et équitable (financières, symboliques, statutaires, etc.) ;
- La mise en œuvre d’une organisation du travail laissant des marges de manœuvre au travailleur, pour favoriser l’autonomie et les rapports de confiance tout en se prémunissant de l’isolement (management horizontal, usage raisonné des outils de reporting, rédaction de fiches de postes associant les membres du service concerné, concertation sur le télétravail…).
Textes de référence
Sur les obligations de l’employeur eu matière de santé et de sécurité au travail et les principes généraux de prévention, d’évaluation des risques et de tenue du DUERP
- Articles L. 4121-1 s. du Code du travail
- Articles R. 4121-1 s. du Code du travail
- Circulaire DRT n° 6 du 18 avril 2002 prise pour l’application du décret n° 2001-1016 portant création d’un document relatif à l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, prévue par l’article L. 230-2 du Code du travail et modifiant le Code du travail
Les accords interprofessionnels relatifs à la santé et à la prévention du stress au travail
- Accord national interprofessionnel du 2 juillet 2008 relatif au stress au travail - Légifrance
- Accord national interprofessionnel pour une prévention renforcée et une offre renouvelée en matière de santé au travail et conditions de travail du 9 décembre 2020
Sur la reconnaissance des maladies professionnelles « hors-tableau » :
Lire en complément
Sur les effets sur la santé du stress au travail et les moyens d’action
- Rapport de L’OIT, Le stress au travail : un défi collectif, 2016
- Article l’INRS : Les effets sur la santé du stress au travail.
- Guide de l’INRS Risques psychosociaux. 9 conseils pour agir au quotidien
Sur la démarche « qualité de vie et conditions de travail » et la santé au travail
À lire sur ce site
-
La santé mentale : grande cause nationale
Le Gouvernement a décidé de faire de la santé mentale une grande cause nationale en 2025. Le ministère du Travail, de la Santé,…
Date de mise à jour le
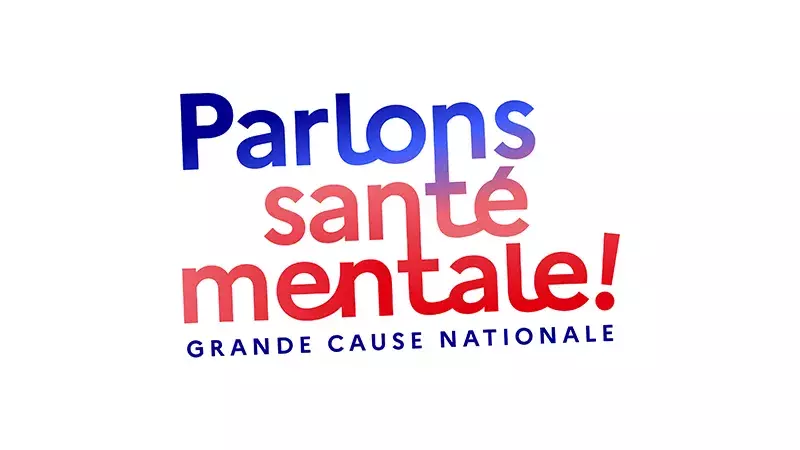
-
Burn-out et risques psychosociaux : comprendre pour mieux prévenir
Le burn-out est un syndrome d' épuisement physique, émotionnel et mental qui résulte d’un investissement prolongé dans des…
Date de mise à jour le
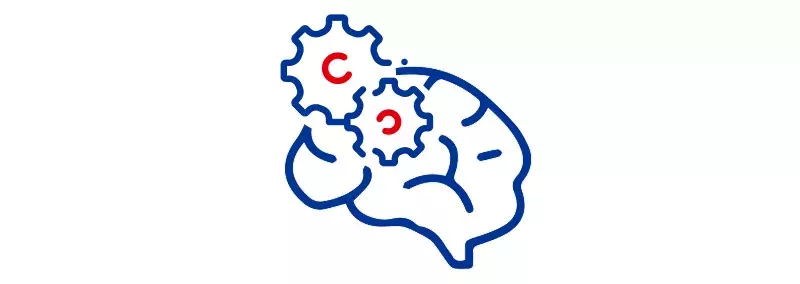
-
Passeport de prévention : un nouveau calendrier de déploiement
Le Passeport de prévention, améliorant la traçabilité des formations en santé et sécurité au travail sera déployé progressivement…
Publié le

-
Les grands principes de la prévention des risques professionnels
Liés aux conditions générales de travail, les risques professionnels représentent les dangers auxquels sont exposés les…
Date de mise à jour le
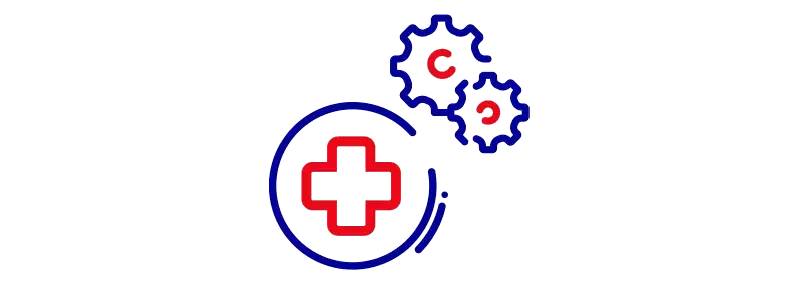
-
Le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP)
L’évaluation des risques constitue une obligation à la charge de l’employeur et l’un des principaux leviers de progrès de la…
Date de mise à jour le
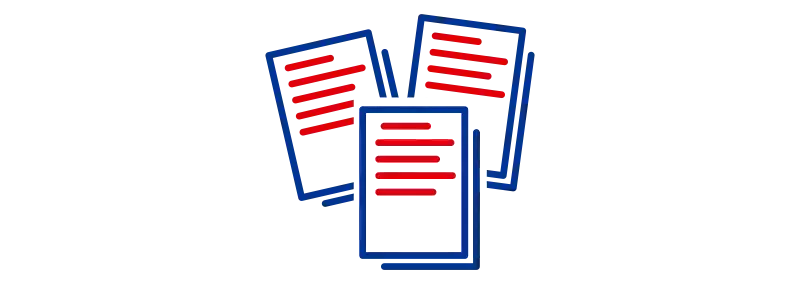
-
La prévention des risques psychosociaux (RPS)
Les risques psychosociaux sont définis comme un risque pour la santé physique et mentale des travailleurs. Leurs causes sont à…
Date de mise à jour le