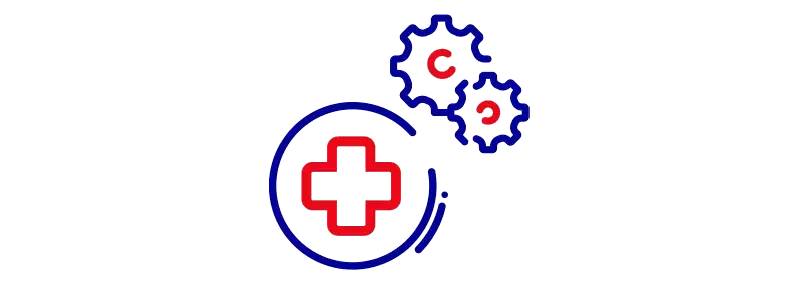La prévention du suicide au travail
Publié le Mis à jour le |
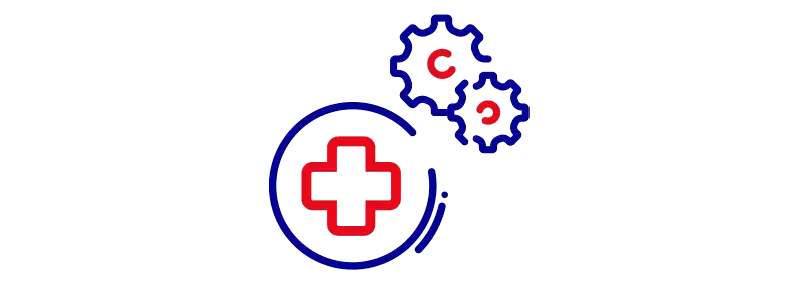
- Les suicides survenant pendant le temps de travail, sur le lieu de travail ou en rapport direct avec une souffrance liée au travail sont considérés comme des accidents de travail.
- Même sans lien avec le travail, le suicide d’un salarié, reste un événement éprouvant pour le collectif de travail et doit être pris en compte par l’employeur.
- La tentative de suicide ou le suicide, manifestation d’une souffrance psychique extrême, met en évidence la nécessaire prévention des risques psychosociaux (RPS) susceptibles d’affecter la santé mentale des travailleurs.
- Ces RPS doivent être évalués et traités par les employeurs, au titre de leur obligation d’assurer la santé et la sécurité des travailleurs (articles L. 4121-1 et suivants du Code du travail).
- L’Institut national de Recherche et Sécurité (INRS) classe les facteurs de risque psychosociaux en 6 catégories :
- Intensité et temps de travail ;
- Exigences émotionnelles (exemple : dans le cadre des activités de soins aux personnes) ;
- Faible autonomie au travail ;
- Rapports sociaux dégradés ;
- Insécurité de la situation de travail.
- Ces risques doivent aussi être analysés d’un point de vue collectif, en tant que conséquence de changements et dysfonctionnements complexes liés à l’organisation du travail ou à l’évolution d’un secteur d’activité.
- En cas de tentative de suicide ou de suicide, il incombe à l’employeur de prendre les mesures adéquates pour déterminer les éventuels dysfonctionnements et manquements ayant conduit à cet événement et de mener les actions de nature à préserver la santé des travailleurs.
- Enfin, l’employeur doit prendre des mesures adaptées pour protéger la santé mentale des autres salariés qui ont pu être affectés par l’événement (cellule de soutien psychologique, d’écoute…).
À savoir !
Le numéro national de prévention du suicide, le 3114, est accessible sept jours sur sept et vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Des professionnels de la santé mentale (psychologues, médecins, infirmiers) écoutent et conseillent les personnes en souffrance, leurs proches, ainsi que les professionnels en recherche d’informations sur la prévention du suicide ou ayant besoin d’un avis spécialisé.
Pour en savoir plus, consulter le site Internet du numéro national de prévention du suicide : https://3114.fr/
Selon la définition donnée par l’INRS, « le suicide, action de se donner volontairement la mort, fait partie d’un ensemble d’actes appelés conduites suicidaires : suicide, tentative de suicide, idées suicidaires, crise suicidaire (risque suicidaire élevé), équivalents suicidaires (automutilation, conduites à risque...) ».
Il s’agit d’un phénomène complexe et multifactoriel.
Après la vague de suicides à France Télécom (2006 - 2011), le suicide au travail (survenant sur le temps ou le lieu de travail, ou en lien avec le travail) est apparu comme un risque psychosocial majeur pour les pouvoirs publics, les instances de représentation du personnel et les employeurs.
Ainsi, « il est désormais bien documenté que des facteurs liés à l’organisation du travail ou certaines pratiques de management peuvent engendrer des conditions de travail stressantes et créer des risques psychosociaux » (Synthèse du quatrième rapport de l’Observatoire national du suicide, juin 2020).
- Lorsqu’il survient pendant le temps ou sur le lieu de travail, le suicide (ou la tentative de suicide) est présumé être un accident de travail, à déclarer comme tel par l’employeur. Il sera ainsi reconnu comme accident du travail par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), sauf si l’employeur démontre que la cause est totalement étrangère au travail.
En outre, un suicide survenu hors du temps et du lieu de travail, mais dont les causes sont liées au travail, peut être reconnu comme un accident de travail par la CPAM.
Dans un arrêt du 22 février 2007, la Cour de cassation a considéré que la tentative de suicide survenue au domicile du salarié, tandis que ce dernier se trouvait en arrêt maladie en raison d’un syndrome anxio-dépressif lié à la dégradation continue de ses conditions de travail, constituait bien un accident de travail. En effet, quand bien même le salarié ne se trouvait plus sous la subordination de l’employeur, il a été établi que l’accident était survenu par le fait du travail.
(Cass. 2e civ., 22 février 2007, n° 05-13.771)
La CPAM diligente généralement une enquête pour comprendre les circonstances de survenue d’un tel sinistre.
Indépendamment des poursuites pénales, la famille ou la victime (dans le cas d’une tentative de suicide), peut solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, devant le pôle social du tribunal judiciaire, en prouvant que l’employeur connaissait ou aurait dû connaître le danger auquel était exposé le travailleur et n’a pas pris toutes les mesures pour l’éviter.
Le suicide d’un travailleur, même sans lien avec le travail, est un événement très déstabilisant, avec un risque pour la santé mentale des collègues, en particulier s’ils étaient proches de la victime ou s’ils en ont vu le corps. Le deuil après suicide est en effet lui-même un facteur majeur de passage à l’acte suicidaire.
La prévention du suicide au travail, qui comprend aussi l’accompagnement des endeuillés en « postvention », relève de l’obligation faite à l’employeur de protéger la santé de ses salariés. Cela implique d’évaluer tout particulièrement de prévenir les risques psychosociaux et de mettre en œuvre le plan d’action adéquat.
L’évaluation et la prise en considération des risques psychosociaux
L’évaluation des risques est une obligation légale à la charge de l’employeur et l’un des principaux leviers de progrès dans la prévention des risques professionnels.
Évaluer les facteurs de RPS permet d’agir sur les causes organisationnelles pouvant générer de la souffrance au travail et, dans les cas extrêmes, conduire à un suicide.
Conformément à l’article L. 4121-1 du Code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
- la mise en œuvre d’actions de prévention des risques professionnels ;
- des actions d’information et de formation ;
- l’adaptation des organisations en fonction de l’évolution des risques et la mise en place de moyens adaptés.
L’employeur doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Six grandes familles de facteurs de risques psychosociaux sont identifiées :
- Exigences du travail : surcharge ou sous-charge, pression temporelle, objectifs flous ou inatteignables.
- Exigences émotionnelles : relation à la clientèle, gestion des émotions, exposition à la souffrance.
- Manque d’autonomie : absence de marge de manœuvre, contrôle excessif.
- Rapports sociaux dégradés : conflits, isolement, absence de soutien hiérarchique ou collègue.
- Conflits de valeurs : sentiment d’incohérence entre le travail demandé et ses valeurs professionnelles.
- Insécurité socio-économique : crainte de la perte d’emploi, manque de reconnaissance.
L’évaluation des risques constitue un moyen essentiel pour préserver la santé et la sécurité des travailleurs, grâce à un diagnostic systématique et exhaustif des risques.
- L’employeur transcrit et met à jour les résultats de cette évaluation dans le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP).
Voir aussi Les grands principes de la prévention des risques professionnels et le DUERP.
Le Baromètre santé 2017 de Santé publique France a révélé que les pensées suicidaires liées à l’activité professionnelles étaient associées à :
- des menaces verbales ;
- des humiliations et des intimidations au travail ;
- à la peur de perdre son emploi ;
- au fait d’avoir connu récemment une période de chômage de plus de six mois.
L’existence de ces différents facteurs de risques et leur interaction au sein de la structure peuvent concourir à la survenue de souffrance au travail susceptible de mener au suicide de travailleurs.
Les leviers de prévention
La prévention du suicide au travail repose sur des leviers complémentaires, à la fois collectifs et individuels.
Approche collective
- Mettre en œuvre une prévention primaire pour agir sur les causes organisationnelles (charge de travail, horaires, autonomie, reconnaissance…).
- Développer le dialogue social et associer les représentants du personnel à l’analyse et à la recherche de solutions.
- Former l’encadrement à détecter les signaux faibles (changement de comportement, isolement, fatigue inhabituelle, irritabilité…).
- Adapter les méthodes de management pour réduire les sources de stress et favoriser le soutien social.
Approche individuelle
- Proposer un soutien psychologique aux salariés en difficulté (ligne d’écoute, cellule de crise, accompagnement individuel).
- Faciliter l’accès à la médecine du travail et aux services de santé au travail pour toute demande spontanée ou signalement.
- Favoriser la parole des salariés et combattre la stigmatisation des troubles psychiques.
De plus, la prévention doit être intégrée à la politique globale de santé et sécurité, avec des actions planifiées, évaluées et ajustées régulièrement.
Les mesures d’urgence après un passage à l’acte
Une tentative ou un suicide au sein d’une équipe – quand bien même ses causes sont sans lien avec le travail – revêt un risque psychosocial majeur pour les autres travailleurs.
- En effet, il existe un danger important de « contagion suicidaire ».
Les personnes exposées directement ou indirectement à un tel événement sont plus à risque d’avoir des idées suicidaires, ou même de passer à l’acte. Au niveau individuel, être exposé à un suicide multiplierait de deux à quatre fois le risque de passage à l’acte. Au niveau collectif, les exemples de suicides en séries dans des institutions (notamment en entreprises), des corps de métiers ou des lieux identifiés sont fréquents.
Lire également la contagion suicidaire sur le site du ministère de la Santé .
Lorsque le passage à l’acte se produit sur le lieu de travail, l’employeur doit immédiatement prendre des mesures pour soustraire les autres salariés à la vue d’une scène choquante susceptible de générer des chocs traumatiques.
Par ailleurs, il prend également toutes les mesures urgentes de nature à garantir la santé et la sécurité de ces derniers (a fortiori pour les collègues directs de la victime ou témoins) : cellules d’écoute, orientation vers une assistance psychologique, interventions d’experts en concertation avec la médecine du travail…
Ces mesures peuvent être utilement anticipées dans le cadre d’un plan de postvention, à élaborer dans le cadre du plan d’action du DUERP, en amont de la survenue d’un suicide ou, plus généralement, d’un accident du travail grave ou mortel.
Les actions à mener à la suite du passage à l’acte suicidaire d’un travailleur
Que faire en cas de suicide ou de tentative de suicide ?
En cas d’événement suicidaire survenu au travail, l’employeur doit intervenir immédiatement pour protéger les salariés et respecter ses obligations légales.
Mesures d’urgence
- Prévenir les secours et sécuriser les lieux.
- Informer la famille et proposer un accompagnement psychologique.
- Alerter le service de prévention et de santé au travail.
Obligations administratives
- Si l’événement a eu lieu sur le temps et le lieu de travail, il doit être déclaré dans les 48 heures à la CPAM comme accident du travail.
- Si le travailleur est décédé, l’employeur doit en informer immédiatement l’inspection du travail et au plus tard dans les douze heures.
- Conserver toutes les informations utiles pour l’enquête de la CPAM.
Prise en charge des équipes
- Organiser un soutien collectif (cellule d’écoute, psychologues, aménagement temporaire du travail…).
- Favoriser la parole et la reconnaissance de l’événement au sein des équipes.
Analyse et prévention
- Identifier les causes et facteurs contributifs pour prévenir de nouveaux passages à l’acte suicidaire.
Textes de référence
- Sur la prévention des risques professionnels et les obligations de l’employeur : articles L. 4121-1 s du Code du travail
- Sur l’exercice du droit d’alerte : article L. 2312-59 du Code du travail
- Sur l’expertise CSE en cas de risque grave, identifié et actuel : article L. 2315-14 du Code du travail
- Sur les enquêtes du CSE en matière d’accidents de travail et de maladies professionnelles : article L. 2312-13 du Code du travail
- Sur la déclaration d’un accident du travail par l’employeur à l’Assurance maladie : articles R. 441-1 à R. 441-18 du code de la sécurité sociale
- Sur la déclaration d’un accident mortel à l’inspection du travail : Article R4121-5 - Code du travail - Légifrance
- Sur la reconnaissance d’accident de travail : articles L. 441-1 s. du Code de la sécurité sociale
- Sur la faute inexcusable de l’employeur : articles L. 452-1 s. du Code de la sécurité sociale
En savoir plus
- Sur la prévention du suicide
- Sur le 3114, numéro national de prévention du suicide
- Quatrième rapport de l’Observatoire national du suicide sur le lien entre le suicide, le travail et le chômage
- Guide publié par Vies 37 et l’Union nationale pour la prévention du suicide
Lire en complément
-
Les grands principes de la prévention des risques professionnels
Liés aux conditions générales de travail, les risques professionnels représentent les dangers auxquels sont exposés les…
Date de mise à jour le
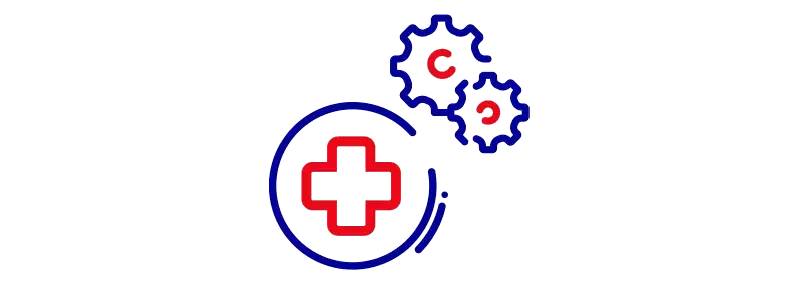
-
La prévention des risques psychosociaux (RPS)
Les risques psychosociaux sont définis comme un risque pour la santé physique et mentale des travailleurs. Leurs causes sont à…
Date de mise à jour le
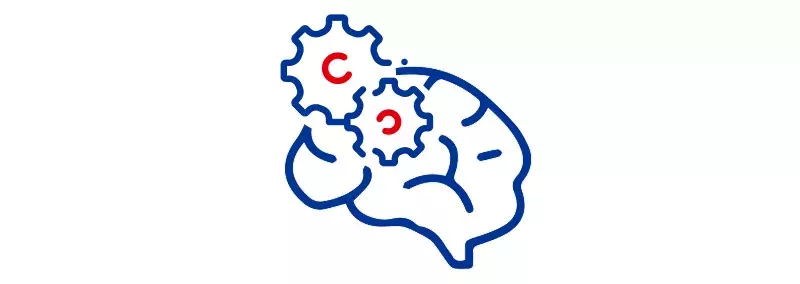
-
Le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP)
L’évaluation des risques constitue une obligation à la charge de l’employeur et l’un des principaux leviers de progrès de la…
Date de mise à jour le
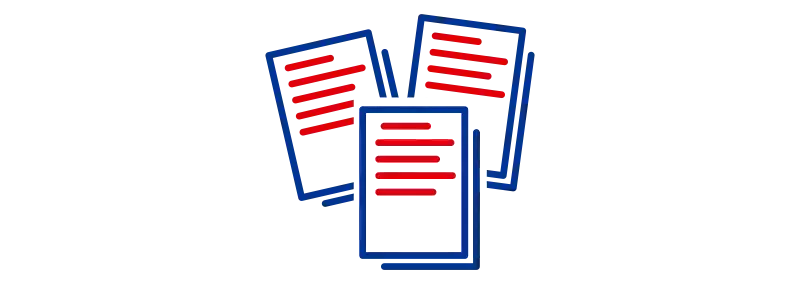
-
Le rôle des acteurs de la santé au travail face aux risques professionnels
Vous êtes employeur et vous souhaitez être accompagné dans la mise en œuvre de votre démarche de prévention ? Vous travaillez au…
Date de mise à jour le