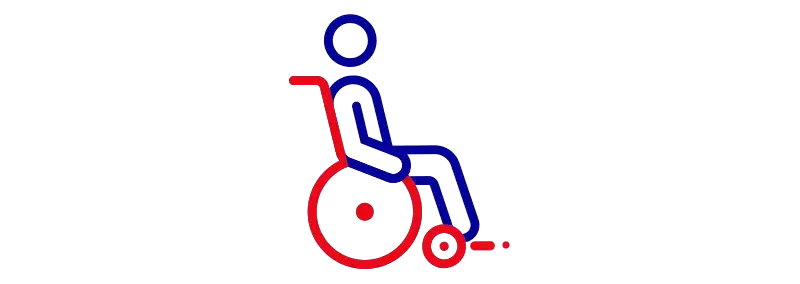Les établissements ou services d'accompagnement par le travail (ESAT)
Publié le Mis à jour le 24/12/2025 |
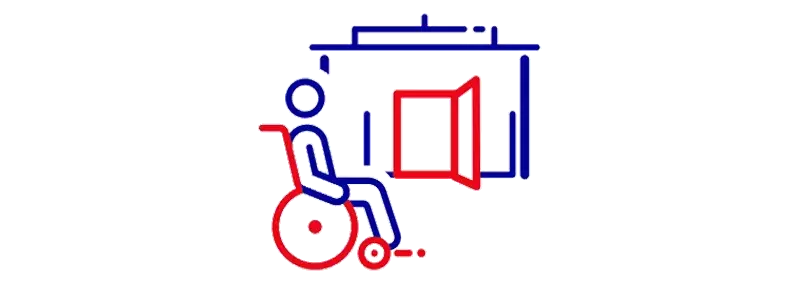
- Les établissements ou services d'aide par le travail (ESAT) (auparavant appelés « centres d'aide par le travail » ou CAT) sont des établissements médico-sociaux qui relèvent, pour l'essentiel, des dispositions figurant dans le Code de l'action sociale et des familles.
- La loi pour le plein emploi du 18 décembre 2023 est venue renforcer les droits individuels et collectifs des travailleurs handicapés accueillis en ESAT : remboursement de titres de transport, complémentaire santé obligatoire, droit de grève, droit d’adhérer à un syndicat… en application des dispositions du Code du travail.
- Les ESAT offrent aux personnes handicapées des activités diverses à caractère professionnel et un soutien médico-social et éducatif en vue de favoriser leur épanouissement personnel et social.
Dernières actualités
Par la loi pour le plein emploi du 18 décembre 2023, les travailleurs handicapés accueillis en ESAT bénéficient de nouveaux droits individuels et collectifs, garantis par l’application du Code du travail :
- la prise en charge par l'employeur des frais de transport, d’une couverture complémentaire santé obligatoire et, sous condition, de titres-restaurant et de chèques vacances ;
- le droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation du travail ;
- le droit d'adhérer à un syndicat professionnel et de s'en retirer ;
- le droit de grève ;
- les droits d'alerte et de retrait en cas de danger grave et imminent ;
- Les décrets n° 2025-844 du 25 août 2025 et n° 2025-845 du 25 août 2025 sont notamment venus préciser les modalités d’exercice de ces droits.
Qui peut être accueilli dans un ESAT ?
Les établissements ou services d'accompagnement par le travail accueillent des personnes handicapées dont la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a constaté que les capacités de travail ne leur permettent, momentanément ou durablement, à temps plein ou à temps partiel, ni de travailler dans une entreprise dite « ordinaire » ou dans une entreprise adaptée (ex. atelier protégé) ou pour le compte d'un centre de distribution de travail à domicile (CDTD), ni d'exercer une activité professionnelle indépendante. Ils leur offrent des possibilités d'activités diverses à caractère professionnel, ainsi qu'un soutien médico-social et éducatif, en vue de favoriser leur épanouissement personnel et social. La personne handicapée qui souhaite bénéficier d’une orientation professionnelle doit en faire la demande à la CDAPH en utilisant le formulaire de demande unique.
À titre dérogatoire, par convention conclue entre France Travail, Cap Emploi et les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), ces dernières peuvent orienter un travailleur handicapé vers un ESAT sur le fondement de propositions formulées par France Travail ou les organismes Cap Emploi.
Cette mesure est actuellement en « phase pilote » dans 11 agences France Travail réparties sur cinq départements depuis le mois de novembre 2024. Le dispositif sera généralisé au 1er janvier 2027.
La commission prend une décision provisoire d'orientation. À l’issue de la période d’essai (qui ne peut excéder 3 mois, sauf sur proposition de prolongation de 3 mois émise par le directeur d’établissement ou le service d’accompagnement par le travail, soit 6 mois en tout) au sein de l’ESAT, la commission prononce la décision définitive d'admission. La période d’essai peut être réduite ou prolongée selon le cas, mais aussi prorogée en cas d’absence de la personne handicapée
- Les ESAT relèvent du milieu « protégé », par opposition au milieu « ordinaire » de travail. Ils mettent en œuvre ou favorisent l'accès à des actions d'entretien des connaissances, de maintien des acquis scolaires et de formation professionnelle, ainsi que des actions éducatives d'accès à l'autonomie et d'implication dans la vie sociale, au bénéfice des personnes handicapées qu'ils accueillent ;
- L'orientation dans un ESAT vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).
En principe, la personne handicapée doit être âgée d’au moins 20 ans ; toutefois, à titre exceptionnel, une personne handicapée peut être admise en ESAT dès l’âge de 16 ans.
Dans les conditions précisées par les articles R. 146-31 à R. 146-31-5 du code de l’action sociale et des familles, des périodes de mise en situation en milieu professionnel peuvent être prescrites, au bénéfice des personnes handicapées, dans les établissements ou services d'accompagnement par le travail. Ces périodes ont pour objet, en fonction du projet de vie de la personne concernée, soit de compléter ou de confirmer l'évaluation faite par l'équipe pluridisciplinaire chargée, au sein de la MDPH, d’évaluer les besoins de compensation de la personne handicapée, soit de mettre en œuvre les décisions d'orientation professionnelle prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Ces périodes de mise en situation en milieu professionnel font l'objet d'une convention entre le bénéficiaire et l'établissement ou service dans lequel il effectue la mise en situation professionnelle ; cette convention est conforme au modèle fixé par l’arrêté du 28 mars 2017 cité en référence, en vigueur depuis le 8 avril 2017.
Comment fonctionnent les ESAT ?
La création des ESAT est autorisée par arrêté du préfet, qui fixe le nombre de places. Ils peuvent être publics ou privés.
En raison de leur double vocation (mise au travail et soutien médico-social), les ESAT disposent de personnels d'encadrement des activités de production et de travailleurs sociaux assurant les soutiens éducatifs et ce grâce à un budget de fonctionnement financé par les crédits d'action sociale de l'État.
Les dispositions du Code du travail s'appliquent aux ESAT en ce qui concerne l'hygiène, la sécurité et la médecine du travail.
Au plus tard le 30 avril de chaque année, les ESAT doivent présenter à l’Agence régionale de santé (ARS) un rapport sur leur politique en faveur des travailleurs handicapés qu'ils accueillent.
Sur le fondement de ce rapport, le directeur général de l’ARS peut fixer des objectifs à l'établissement ou au service d'accompagnement par le travail concernant le niveau moyen de la participation financière de ce dernier à la rémunération garantie des travailleurs, ainsi que sur sa contribution au développement de la formation et la diversification des activités professionnelles, en particulier à l'extérieur de l'établissement.
Quel est le statut des personnes accueillies en ESAT ?
La personne handicapée accueillie en ESAT n’a pas le statut de salarié soumis au Code du travail, ne bénéficie pas d’un contrat de travail et ne peut faire l’objet d’un licenciement.
Cependant, elle doit signer, avec l’ESAT, un contrat d’accompagnement par le travail, conforme au modèle figurant à l’annexe 3.9 du Code de l’action sociale et des familles modifié par décret n° 2025-845 du 25 août 2025.
Ce contrat est conclu pour une durée d'un an et est reconduit chaque année par tacite reconduction.
L'établissement ou le service s'engage à tout mettre en œuvre pour permettre à la personne handicapée de bénéficier de toute action d'entretien des connaissances, de maintien des acquis scolaires, de formation professionnelle susceptibles de favoriser le développement de ses compétences et de diversifier son parcours professionnel au sein du milieu protégé ou vers le milieu ordinaire de travail.
Notons que la loi pour le plein emploi du 18 décembre 2023, déjà citée, entend rapprocher le statut du travailleur handicapé accueilli en ESAT de celui du salarié.
Ainsi, elle introduit des droits individuels et collectifs pour les travailleurs handicapés accueillis en ESAT, garantis par le Code du travail :
- la prise en charge par l'employeur des frais de transport, d’une couverture complémentaire santé obligatoire, et sous condition de titres-restaurant et de chèques vacances ;
- le droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation du travail ;
- le droit d'adhérer à un syndicat professionnel et de s'en retirer ;
- le droit de grève ;
- les droits d'alerte et de retrait en cas de danger grave et imminent ;
- Les décrets n° 2025-844 du 25 août 2025 et n° 2025-845 du 25 août 2025 précités, en vigueur depuis le 28 août 2025, précisent les modalités d’exercice de ces droits.
Droit à congé
Les travailleurs handicapés accueillis en ESAT peuvent bénéficier du congé de présence parentale et ont accès, depuis le 1er janvier 2007, dans les conditions fixées par les articles R. 243-12 et R. 243-13 du Code de l'action sociale et des familles, à certains droits à congé prévus par le Code du travail et à la validation des acquis de leur expérience.
Ils bénéficient également, lorsqu’ils justifient d'un mois de présence dans l’ESAT, d’un congé annuel, qui donne lieu au versement de la rémunération garantie (voir ci-dessous) et dont la durée est déterminée à raison de 2,5 jours ouvrables par mois d'accueil en ESAT ; la durée totale de ce congé, qui ne peut excéder 30 jours ouvrables, peut être augmentée de 3 jours mobiles, dont l'attribution est laissée à l'appréciation du directeur de l’ESAT.
Le travailleur handicapé accueilli en ESAT a également droit :
- à un congé de 24 heures minimum, pour chaque action de validation des acquis de l'expérience (VAE), pendant la durée duquel il a droit au maintien de sa rémunération garantie. La durée de ce congé ne peut être imputée sur la durée du congé annuel mentionné ci-dessus ; elle est assimilée à un temps d'activité à caractère professionnel pour la détermination des droits de l'intéressé en matière de congé annuel ou de tout autre droit ou avantage subordonné à une condition d'ancienneté dans l’ESAT ;
- lorsqu’il accède à une action de formation professionnelle, à un congé de formation qui le dispense en tout ou partie de l'exercice de son activité à caractère professionnel et pendant la durée duquel il bénéficie du maintien de sa rémunération garantie.
Accès à la formation et VAE
Les ESAT mettent en œuvre ou favorisent l'accès à des actions d'entretien des connaissances, de maintien des acquis scolaires et de formation professionnelle, au bénéfice des personnes handicapées qu'ils accueillent.
Les travailleurs handicapés accueillis en ESAT ont également accès à la validation des acquis de l’expérience, qui vise à leur permettre d'obtenir tout ou partie d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification professionnelle, enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles, dès lors qu'ils peuvent se prévaloir d'une expérience à caractère professionnel d'au moins 3 ans en lien avec la certification visée. Les travailleurs handicapés bénéficient du régime de droit commun de validation des acquis de l'expérience déterminé par le certificateur dont relève la certification visée et, le cas échéant, des aménagements d'épreuves liés à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
À cette fin, les travailleurs handicapés accueillis en ESAT devront disposer d'un carnet de parcours et de compétences, dont le modèle doit être fixé par décret (en attente).
Lors de chaque entretien annuel, ce carnet permettra à la personne accompagnée d'évaluer elle-même ses compétences, ses formations et expériences et d'exprimer ses souhaits pour l'année à venir. Le carnet de parcours et de compétences sera la propriété du travailleur handicapé, qui le conservera quel que soit le lieu d’exercice de son activité à caractère professionnel.
Les modalités de mise en œuvre des dispositions qui précèdent sont fixées par les articles D. 243-14 à D. 243-31 du Code de l’action sociale et des familles.
La personne d’au moins 16 ans admise en ESAT, ayant conclu un contrat d’accompagnement par le travail, bénéficie d’un compte personnel de formation (CPF). Celui-ci est alimenté en heures de formation à la fin de chaque année et mobilisé par le titulaire ou son représentant légal afin qu'il puisse suivre, à son initiative, une formation. Le compte ne peut être mobilisé qu'avec l'accord exprès de son titulaire ou de son représentant légal. Les dispositions applicables, issues de la loi du 8 août 2016 citée en référence, figurent aux articles L. 6323-33 à L. 6323-41 du Code du travail.
Rémunération garantie
Tout travailleur handicapé accueilli dans un ESAT a droit à une « rémunération garantie » (qui s'est substituée à l'ancienne « garantie de ressources ») versée par l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail qui l'accueille et qui tient compte du caractère à temps plein ou à temps partiel de l'activité qu'il exerce.
Cette rémunération est versée dès l'admission en période d'essai du travailleur handicapé sous réserve de la conclusion du contrat d’accompagnement par le travail.
Pour les travailleurs handicapés admis dans un ESAT qui exercent une activité à caractère professionnel à temps plein, le montant de cette rémunération garantie est compris entre 55,7 % et 110,7 % du SMIC (ces taux s'appliquent aux droits ouverts en matière de rémunération garantie à compter du 1/1/2018) ; l'exercice d'une activité à temps partiel, quelle qu'en soit la durée, entraîne une réduction proportionnelle du montant de cette rémunération garantie. Afin d'aider les ESAT à la financer, l'État verse une « aide au poste » pour chaque personne handicapée accueillie.
Lorsque le travailleur handicapé accueilli en ESAT accède à une action de formation professionnelle, il bénéficie d'un congé de formation qui le dispense en tout ou partie de l'exercice de son activité à caractère professionnel. Pendant la durée de ce congé de formation, le travailleur handicapé bénéficie du maintien de sa rémunération garantie.
Les modalités de fixation de cette rémunération garantie sont précisées par les articles R. 243-5, R. 243-6 et R. 243-7 du Code de l’action sociale et des familles.
L'ESAT peut, en application de l'article R. 314-5 du Code de l'action sociale et des familles, décider d'affecter une partie de son excédent d'exploitation à l'intéressement des travailleurs handicapés. Dans ce cas, le montant de la prime versée à ce titre à chacun de ceux-ci est limité à un plafond égal à 10 % du montant total annuel de la part de rémunération garantie directement financée par l'ESAT pour ce même travailleur au cours de l'exercice au titre duquel l'excédent d'exploitation est constaté. Cette prime d'intéressement à l'excédent d'exploitation, qui doit être portée sur le bulletin de paie correspondant au mois de son versement, est assujettie au versement des cotisations dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales. La part de cotisations incombant à l'ESAT ne donne pas lieu à compensation par l'État. Lorsqu'elle est versée, cette prime d'intéressement n'entre pas en compte pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.
Mise à disposition d'une entreprise
Lorsque l'exercice d'une activité à caractère professionnel en milieu ordinaire de travail est susceptible de favoriser l'épanouissement personnel et professionnel et de développer la capacité d'emploi de travailleurs handicapés admis dans un ESAT, cet établissement ou ce service peut, avec l'accord des intéressés et dans les conditions définies par les articles R. 344-16 à R. 344-21 du Code de l'action sociale et des familles, mettre une ou plusieurs personnes handicapées à la disposition d'une entreprise, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public, d'une association ou de toute autre personne morale de droit public ou de droit privé ainsi qu'auprès d'une personne physique.
Quelles que soient les modalités d'exercice de cette activité à caractère professionnel en milieu ordinaire de travail, les travailleurs handicapés concernés continuent à bénéficier d'un accompagnement médico-social et professionnel assuré par l'établissement ou le service d'aide par le travail auquel ils demeurent rattachés.
Un contrat écrit doit obligatoirement être passé entre l'ESAT et la personne physique ou morale auprès de laquelle la mise à disposition est réalisée. Ce contrat doit comporter l'ensemble des mentions obligatoires visées à l'article R. 344-17 du code de l'action sociale et des familles.
Ce contrat précise notamment :
- le nom du ou des travailleurs handicapés concernés ;
- la nature de l'activité ou des activités confiées aux travailleurs handicapés, ainsi que le lieu et les horaires de travail ;
- la base de facturation à l'utilisateur du travail fourni ou du service rendu, les conditions dans lesquelles l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail assure au travailleur handicapé l'accompagnement qui lui incombent ;
- les conditions dans lesquelles est exercée la surveillance médicale du travailleur handicapé ;
- les mesures prévues pour assurer l'adaptation du travailleur handicapé à son nouveau milieu de travail.
Lorsqu'il porte sur la mise à disposition individuelle d'un ou plusieurs travailleurs handicapés nommément désignés, sa durée est au maximum de 2 ans et il doit être communiqué à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) dans les quinze jours qui suivent sa signature. La prolongation au-delà de deux ans de cette mise à disposition du travailleur handicapé est subordonnée à l'accord de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Cet accord est demandé par le directeur de l'ESAT.
Les personnes handicapées nécessitant un accompagnement médico-social pour s'insérer durablement dans le marché du travail, en particulier les travailleurs handicapés accueillis dans un ESAT et ayant un projet d'insertion en milieu ordinaire de travail, peuvent bénéficier du dispositif d'emploi accompagné.
Embauche en milieu ordinaire
Lorsqu'une personne handicapée accueillie dans un ESAT conclut un contrat de travail à durée indéterminée, un contrat de travail à durée déterminée (CDD), un contrat de travail temporaire, un contrat unique d'insertion-contrat d'accompagnement dans l'emploi (CUI-CAE), un contrat unique d'insertion-contrat initiative-emploi (CUI-CIE), un contrat d’apprentissage ou un contrat de professionnalisation, elle peut bénéficier, avec son accord ou celui de son représentant légal, d'une convention passée entre l'ESAT, son employeur et éventuellement le service d'accompagnement à la vie sociale. Cette convention précise les modalités de l'appui apporté par l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail et éventuellement le service d'accompagnement à la vie sociale au travailleur handicapé et à son employeur pendant la durée du contrat de travail, pour une durée minimale d’un an et maximale de trois ans.
La sortie d'un établissement ou d'un service d'accompagnement par le travail vers le milieu ordinaire de travail s'effectue dans le cadre d'un parcours renforcé en emploi.
Le décret n° 2025-845 du 25 août 2025, en vigueur depuis le 28 août 2025, fixe les modalités de ce parcours renforcé en emploi. Ainsi, ce dernier est préparé et formalisé par l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail en lien avec l'employeur. Il est rédigé dans un langage accessible au travailleur handicapé auquel il est transmis au plus tard un mois après la signature du contrat de travail. Il décrit les actions prévues dans la convention d'appui.
En cas de rupture de ce contrat de travail ou lorsqu'elle n'est pas définitivement recrutée par l'employeur au terme de celui-ci, la personne handicapée est réintégrée de plein droit dans l'ESAT d'origine ou, à défaut, dans un autre ESAT avec lequel un accord a été conclu à cet effet. La convention mentionnée ci-dessus prévoit également les modalités de cette réintégration.
Les entreprises du « milieu ordinaire » de travail qui recrutent une personne handicapée sortant d'un Esat peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’une aide de l’Agefiph. Pour toutes précisions sur cette aide, il convient de prendre contact avec la délégation régionale compétente.
Textes de référence
- Articles L. 243-4 à L. 243-6, L. 311-4, L. 312-1, L. 344-2 à L. 344-6 du Code de l'action sociale et des familles (travailleurs handicapés et ESAT)
- Articles R. 146-31 à R. 146-31-5, R. 243-1 à R. 243-13 et R. 344-16 à R. 344-21 du Code de l'action sociale et des familles (travailleurs handicapés et ESAT)
- L. 146-9 du Code de l’action sociale et des familles (recommandations dérogatoires de France Travail et Cap Emploi au titre de l’orientation en ESAT)
- Articles L. 5213-2 et L. 5213-20 et L. 6323-33 à L. 6323-41 du Code du travail (reconnaissance et orientation de travailleurs handicapés ; CPF du titulaire d’un contrat d’accompagnement par le travail)
- Articles art. L. 2281-1 à L. 2281-4 (droit à l’expression directe), L. 2141-1à L. 2141-3 (droit syndical), L. 4131-1 à L. 4132-5 (droit d’alerte et de retrait)
- Articles L. 3261-2 à L. 3261, L. 3262-1 à L. 3262-7, L. 3263-1 du Code du travail (remboursement des titres de transport, titres restaurant, chèques vacances)
- Circulaire DGCS/SD3/2010/97 du 23 mars 2010 relative à la répartition des compétences entre les agences régionales de santé et les directions régionales et départementales en charge de la cohésion sociale sur le champ de la politique du handicap
- Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 (JO du 9) relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels
- Loi n° 2023-1196 pour le plein emploi du 18 décembre 2023 (JO du 19)
- Arrêté du 28 mars 2017 (JO du 7 avril 2017)
- Décret n° 2018-194 du 21 mars 2018 (JO du 23)
- Décret n°2022-1561 du 13 décembre 2022 - art. 2 (validation des acquis de l’expérience)
- Décret n° 2025-845 du 25 août 2025
- Décret n° 2025-1228 du 17 décembre 2025 portant relèvement du salaire minimum de croissance et du minimum garanti (JO du 18 ; SMIC au 1er janvier2026)
À lire sur ce site
-
Handicap | Le travail en milieu ordinaire
Les personnes en situation de handicap qui peuvent être orientées vers un travail en milieu ordinaire bénéficient d’un statut de…
Date de mise à jour le
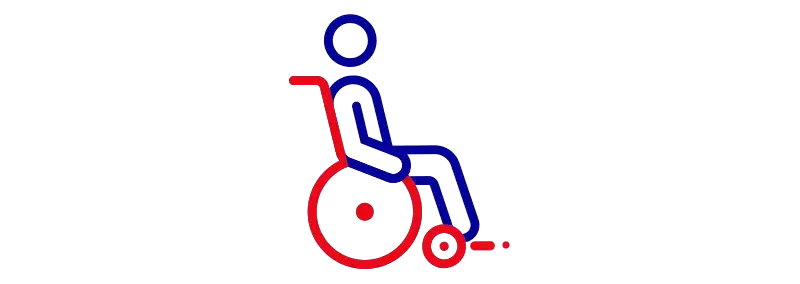
-
Les entreprises adaptées (EA) et entreprises adaptées de travail temporaire (EATT)
Une entreprise adaptée est une entreprise du milieu ordinaire, soumise aux dispositions du code du Travail, qui a la spécificité…
Date de mise à jour le
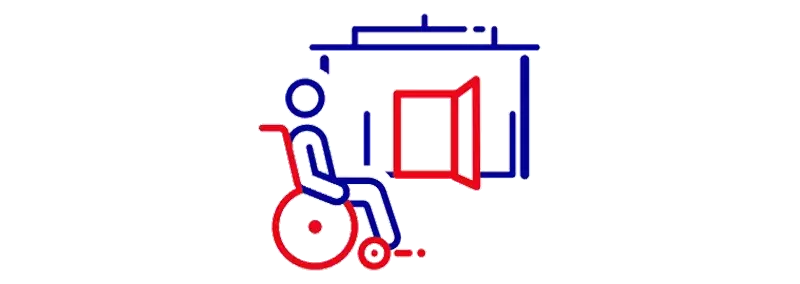
-
Les périodes de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP)
Toute personne accompagnée dans une démarche d’insertion sociale ou professionnelle, et quels que soient son statut, son âge ou…
Publié le
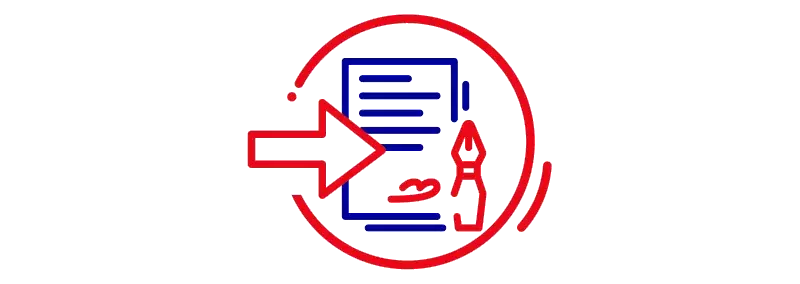
-
Les aides de l'AGEFIPH
L'AGEFIPH gère le fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (FIPH) (article L.5214-1 du Code du travail).
Date de mise à jour le
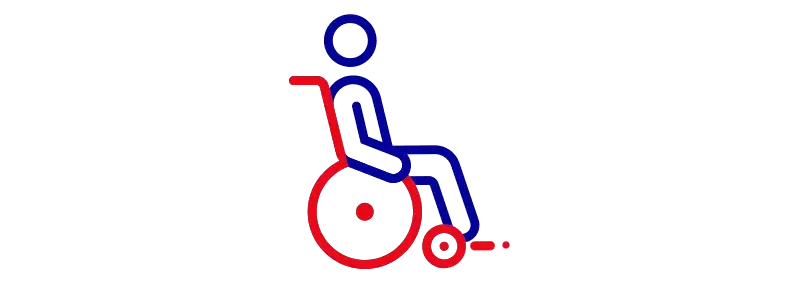
-
L’emploi accompagné
L’emploi accompagné est un dispositif d’appui pour les personnes en situation de handicap destiné à leur permettre d’obtenir et…
Date de mise à jour le